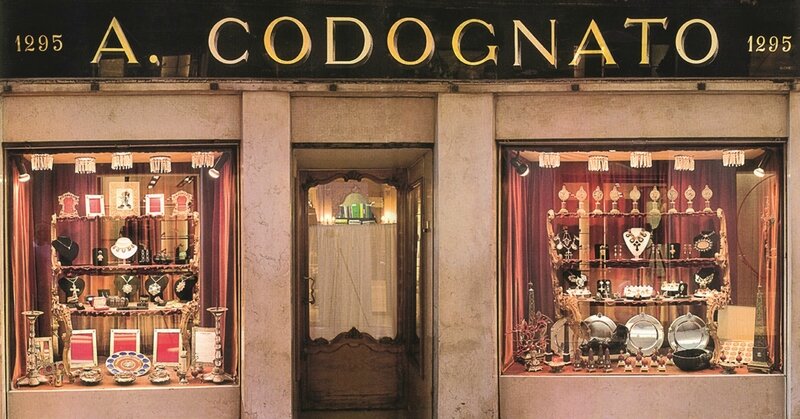Cette partie du blog entend prolonger le contenu du livre intitulé La Faillite de la Democratie, De la nécessité d’un permis de voter
(paru en 2007 aux Editions Bénévent).
Cet ouvrage remet en cause le préjugé qui érige, d’emblée, la démocratie comme meilleur régime politique possible.
Ce propos n’est en aucun cas d’inspiration fasciste. Il est plutôt le fruit d’un esprit d’abord démocrate qui en est venu à se demander si, pour avoir eu raison contre les totalitarismes du XXème siècle, la démocratie devait pour autant être regardée comme le meilleur régime politique possible. Pourquoi, aujourd’hui, aucune critique de la démocratie n’est-elle possible?
Qu’est-ce qui a pu laisser le culte du quantitatif envahir le champ du politique au point de faire passer le régime qui demande l’avis du plus grand nombre pour celui qui était qualitativement le meilleur. Car l’idée selon laquelle il faudrait demander au peuple de choisir les politiques n’a rien d’une nécessité absolue : elle est seulement conventionnelle.
Regardons les scientifiques. Est-ce qu’ils considèrent qu’une proposition validée par mille personnes incompétentes est plus vraie que celle validée par cent scientifiques compétents ? Non. Alors pourquoi n’applique-t-on pas la même idée au domaine politique ?
Pourquoi ce culte du quantitatif qui n’habite même plus les scientifiques, gouverne-t-il encore notre système politique ? Pourquoi un programme politique validé par mille électeurs est-il censé être meilleur que celui qui ne reçoit que huit cents voix ? Pourquoi mille électeurs incompétents sont-ils plus qualifiés à conduire le destin d’un pays que huit cents électeurs aux compétences avérées ?
Les problèmes de la conduite d’une nation seraient-ils tellement moins importants que ceux inhérents à la circulation routière au point qu’on laisse tout le monde et n’importe qui voter alors même qu’on restreint l’usage des voitures aux plus compétents, à ceux qui disposent d’un permis de conduire ?
C’est parce que nous n’acceptons pas ces incohérences de la démocratie que nous défendons une forme d’aristocratie. Attention, il ne s’agit nullement de revenir à une aristocratie de sang! Mais de retrouver le sens originel de l’aristocratie, qui signifie pouvoir des plus compétents. Il convient donc d’instaurer un permis de voter pour permettre aux personnes les plus compétentes de choisir nos dirigeants. En recourant à des électeurs plus compétents, on a toutes les chances de rendre nos dirigeants plus compétents, conscients qu’ils seront du degré d’exigence de ce nouvel électorat.
L’aspect le plus inhabituel de cet ouvrage réside sans doute dans le fait qu’il s’attache à défendre une vérité en matière politique. En effet, contre les relativistes politiques, nous prétendons qu’il existe des régimes politiques mieux fondés que d’autres. Bien évidemment, notre vérité est sujette à débat : elle ne prétend pas être une vérité définitive, absolue, à laquelle chacun devrait se soumettre.
Pour s’approcher d’une vérité politique, il convient de rechercher un système politique à la fois bien fondé et cohérent et donc trouver des principes fondateurs qui soient intangibles.
Nous pensons pouvoir faire reposer un système politique sur les trois principes suivants :
- Le premier est ontologique : nous vivons dans un monde en mouvement, où les rapports de force changent toujours, où des inégalités se créent.
- Le deuxième principe est politique : la politique a pour but de résorber ces inégalités quand elles concernent des êtres humains. Autant le changement d’un rapport de force entre deux objets ou deux espèces animales n’est pas notre priorité, autant l’inégalité entre les hommes est le premier souci de qui s’occupe du vivre-ensemble. Nous ne voyons donc aucun but politique plus primordial que l’égalité des chances.
- Enfin, le troisième principe est anthropologique : l’homme est perfectible et est d’autant plus parfait qu’il sait se projeter dans l’avenir. A ce titre, un même homme n’est pas également parfait au cours de sa vie. Et, au même titre, deux hommes ne sont pas égaux quant à leurs aptitudes à la menuiserie, au commerce ou à la politique.
A partir de ces principes évidents, nous pensons pouvoir dégager un régime politique cohérent (que nous appelons aristocratie) ; un régime qui ne suppose ni un homme divinisé (comme la démocratie) ni un homme réduit à son statut animal (telle la tyrannie).
Etant donné l’inégalité des hommes quant à leurs compétences politiques, il n’est pas équitable de donner à chacun le même droit de vote. Pour obtenir la politique la plus raisonnable, c’est-à-dire la politique qui tend le plus à résorber le mieux les inégalités créées par notre monde mouvant, il faut donc s’en remettre aux individus les plus au fait de la chose politique. C’est pourquoi, pour rendre égales les chances de tous les hommes à faire ce qu’ils veulent de leur vie, on promeut la création d’un permis de voter. Autrement dit, l’inégalité des citoyens nous paraît être le meilleur moyen de répondre à l’inégalité entre les hommes.
En fin de compte, si l’aristocratie nous semble être la solution la plus raisonnable, c’est sans doute parce qu’il prend le mieux en compte cet être du milieu qu’est l’homme. Car, là où la tyrannie déifie un homme, là où la démocratie animalise les hommes, seule l’aristocratie prend les hommes pour ce qu’ils sont : des êtres perfectibles.